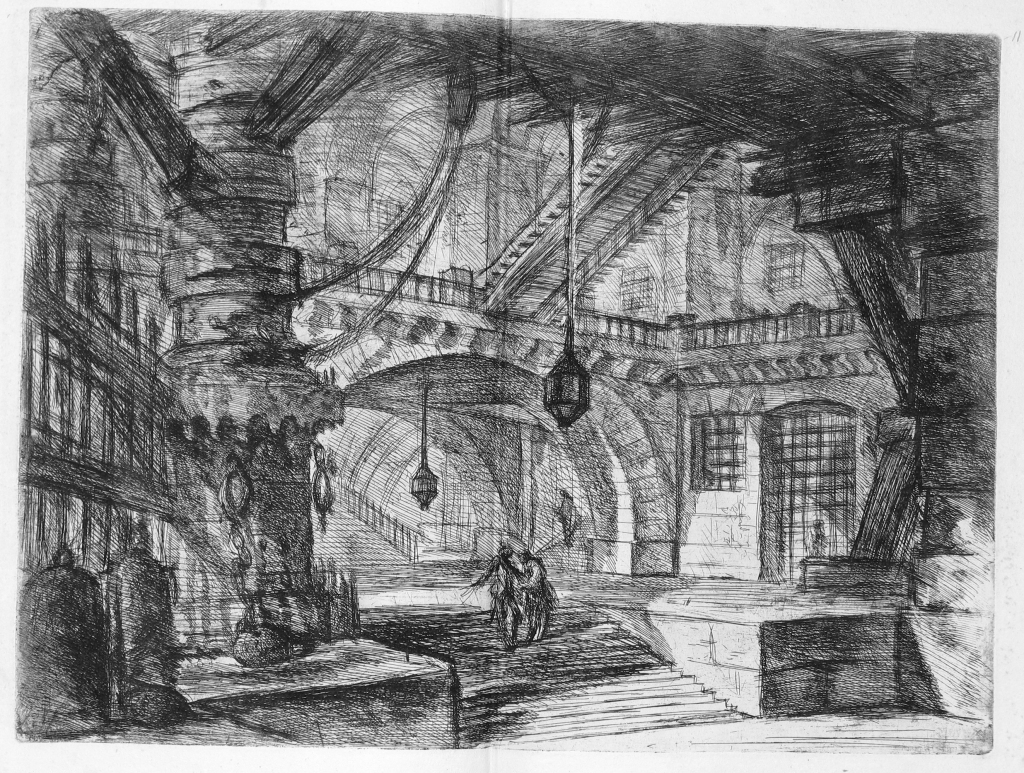
L’utopie est le régime fictionnel le plus connu de la science-fiction, parce qu’elle puise ses racines dans la littérature humaniste ou spirituelle dont Thomas Moore avec Utopia et Tommaso Campanella avec sa Cité du Soleil sont les représentants les plus illustres. Cependant, l’avènement de la crise de la modernité provoqué par la Première Guerre Mondiale, en donnant naissance à la dystopie, interrogea la définition du meilleur des mondes. Dans la littérature qui abonde — de Nous autres de Zamiatine à 1984 de Georges Orwell —, utopie et dystopie ne semblent pas si opposées qu’elles ne semblent l’être au premier coup d’œil. Si la dystopie est probablement une utopie qui a échoué, ce serait cependant une erreur d’écarter la possibilité que l’utopie puisse être une dystopie qui a réussi. Toutes deux ambitionnent la mise en œuvre du bonheur, d’un bonheur prétendument universel auquel nul ne pourrait échapper, et ce par le façonnage méthodique de la société qui doit, in fine, correspondre à cette idée du bonheur. Toutes deux ambitionnent de même de reposer sur un optimum, c’est-à-dire un système où il ne serait plus possible de réformer l’un des points le constituant sans en altérer un autre. À l’aune des œuvres qui constituent le genre, l’utopie se distingue alors par l’abolition de l’État, le dépassement de la politique, et même la négation du zoon politikon cher à Aristote. Mieux, elle évacue le dualisme entre raison et volonté au profit de la première, sans s’interroger rigoureusement sur ce que cette rationalisation recouvre de manière générale. Le rationalisme en l’espèce pousse l’utopie à nous présenter des cités idéales qui fonctionnent par l’élévation intellectuelle et spirituelle des hommes, qui rend toute question politique superflue. L’optimum n’est alors plus seulement d’ordre économique, mais aussi politique, intellectuel et spirituel car sa clef de voûte est l’homme nouveau modelé par l’utopie ou la dystopie. Cet homme nouveau n’est pas l’homo novus des Romains, lequel se caractérisait par son extraction de son milieu social populaire comme un Cicéron. Il est le fruit d’une acculturation scrupuleuse effectuée par le Pouvoir. Comme l’utopie ou la dystopie sont des totalitarisme absolus, l’homme nouveau est une condition sine qua non pour assurer la pérennité du projet politique de l’utopie comme de la dystopie — si tant est que politique soit encore un mot ayant du sens dans un tel cas de figure. La Cité du Soleil repose ainsi sur l’eugénisme et le constructivisme pour modeler son homme nouveau, dépourvu de tout lien avec le passé et même avec la société, comme l’idée d’utopie l’exige. Nous autres procède de même, sauf que l’eugénisme et l’endoctrinement prime sur l’éducation constructiviste voulue par un Campanella. Cependant, ces deux modèles revendique d’agir au nom du plus grand bien. La question qui reste en suspend demeurant la définition de ce plus grand bien, et avec lui du bonheur. C’est parce que ce dernier est abstrait, et que sa nature insaisissable est devenue réifiée par le Pouvoir que ce dernier est total. Il totalise la société dans son ensemble, jusque dans la moindre de ses strates, en premier lieu l’individu.
L’État de droit détient nombre des éléments propres à l’utopie. Parce qu’il consacre la souveraineté du droit sur la réalité effective des choses, il érige donc la raison au détriment de la volonté puisque le droit n’est finalement qu’une constellation de normes qui ont pour objectif de s’appliquer à tous. Mieux, l’État, dans l’État de droit, est hypostasié : il est l’avatar juridique du droit lui-même, au même titre que le Christ serait l’incarnation du divin, à la fois le Fils et le Père. La théologie néo-kantienne ainsi développée par des libéraux comme Krabbe ou Kelsen en vient à nier logiquement les enjeux concrets qui gravitent autour de la souveraineté ou de la politique, parce que le seul ordre qui existerait — et même qui préexisterait à toute chose — serait l’ordre juridique. Cela nous ramène dans le paradigme médiéval où la loi préexistait au pouvoir, la fonction du roi étant de rendre la justice et non de légiférer. L’essence divine du droit conférant une dimension transcendantale à loi perdura jusqu’à l’apparition du roi législateur parfaitement incarnée par Louis XV : « nous ne tenons notre couronne que de Dieu : le droit de faire des lois… nous appartient à nous seul sans dépendance et sans partage. » L’État de droit dont le rôle se bornerait à la reconnaissance juridique des intérêts ressemble au roi médiéval qui se contentait d’appliquer la justice en fonction d’une loi divine. Dans les deux cas, le droit préexiste donc au pouvoir ; la décision n’a pas voix au chapitre, et l’État n’est que le gardien de la loi qu’il se contente de reconnaître ou d’appliquer lorsqu’elle se manifeste à lui. À l’image du roi qui devenait tyran s’il s’écartait des lois, la pensée libérale estime elle aussi que l’État devient totalitaire s’il libère la décision du corsetage législatif. « Il n’y a et ne peut avoir aucune forme d’État sans démocratie en mesure de réaliser la suprématie du droit », affirmait Boris Mirkine-Guetzévitch[1]. Dans les faits cependant, l’État de droit entraîne aussi le dépassement de la politique, quelle que soit sa forme, y compris la démocratie, précisément parce qu’il prétend être le pur produit de la raison. La décision publique n’étant pas un préalable dans ce paradigme qui pense que le droit est à l’épiphanie de toute chose consiste donc logiquement à penser que le rôle de l’État-législateur ne serait rien d’autre que la reconnaissance juridique des intérêts, traduisant la pensée rationnelle, pour ne pas dire rationaliste, qui alimente le concept d’État de droit.
DU BIENFAITEUR AU LÉGISLATEUR
La figure du Législateur à précisément ce quelque chose propre à la littérature utopique ou dystopique. Sa dénomination paraît à nos oreilles recouvrer une forme d’omniscience, comme un démiurge qui serait l’Alpha et l’Oméga du droit en détenant le pouvoir de faire comme de défaire les normes, indépendamment de tout régime politique. Une continuité qui surpasserait celle-là même du pouvoir politique. Figure virtuelle, le Législateur n’est rien d’autre que l’ensemble des parlementaires eux-mêmes dans un régime représentatif comme celui des IIIe et IVe Républiques ; parfois le gouvernement, ou même tous ensembles comme dans la Ve République. Pourtant, nommer la matrice législatrice sous cette appellation curieuse comme s’il s’agissait d’une entité monolithique le porte au-delà des contingences politiques. Dès les cours d’introduction au droit public de premier année en faculté jusqu’à la jurisprudence produite par les juges, il est question du Législateur, objet autonome dissocié du politique. Il les transcende tous. Il s’agit d’une somme supérieure aux parties si pure et virtuelle qu’elle ne souffrirait même pas des aléas politiques comme les changements de majorité. Nommément, qu’est-ce que le Législateur aurait alors de différent d’un Big Brother ou d’un Bienfaiteur ? Il est anonyme, abstrait, désigné uniquement par son rôle vis-à-vis non pas de la société mais du droit. Il n’est à la fois personne de concret tout en recouvrant pourtant une réalité qui, elle, est belle et bien concrète. N’existant que dans l’État de droit, il est à la fois une institution et une autorité, au sens d’auctoritas, car il a autorité sur les citoyens, les juges, et les politiques mêmes, une sorte d’avatar du droit lui-même. Les politiques eux-mêmes ne parlent plus que d’alternance et non plus d’alternative, comme s’il n’y avait plus qu’un seul enjeu que celui de poursuivre une même œuvre, réduisant à néant les querelles idéologiques. Cependant, il n’est pas personnellement prévu par une constitution ou un code juridique parce qu’il n’est pas une seule chose mais une somme d’élus, de ministres, parfois de techniciens. Comme la théorie aristotélicienne, le tout qu’il représente est supérieur aux parties qui le composent. Si le Législateur n’a pas plus de réalité tangible que Big Brother, il en partage un autre trait : il se contente d’être ,et sa simple existence fait force de loi. Nous exécutons et nous nous exécutons en son nom tout simplement parce qu’il est, et que cela suffit. Voilà pourquoi désigner la matrice de la production de normes par un nom unique aux atours démiurgiques aurait dû titiller les intellects de nos plus sémillants publicistes. Bien évidemment, cela reste du domaine lexical et il pourrait sembler quelque peu tiré à quatre épingles d’en chercher des interprétations flirtant avec la métaphysique pour certains. Si les mots ont cependant une importance cruciale en matière juridique, la plupart des juristes mésestiment la nature fictionnelle du droit lui-même.
Toutefois, la rationalisation que nous offre l’État de droit n’est-elle pas justement celle qui nous permettrait d’échapper aux turpitudes des hommes comme des régimes politiques ? En évacuant les partis, les velléités idéologiques, voire les aléas de la vie au profit d’un droit qui n’aurait plus besoin de décision pour se saisir de la réalité, le Législateur n’est-il pas finalement la personnification christique de l’État de droit dans la théologie juridique ? Il n’est plus ni le Parlement ou le gouvernement, pas plus qu’il ne recouvre de dimension politique. Il est au-dessus d’eux comme il se substitue à eux puisqu’il leur laisse l’exécution du système de normes qu’il établit, fidèlement à la conception libérale de Kelsen. Son existence abstraite en fait quelque chose de rationnellement pur dont le seul souci serait de légiférer et ainsi de s’imposer au politique. Le droit qu’il produirait serait un droit certes parfaitement impersonnel, mais déconnecté de la vie de la cité. Il s’agirait tout du moins d’un droit qui estimerait mieux que les politiques ce qui serait bon ou mauvais pour nous, ce qui pose une aporie intellectuelle grave puisque factuellement le Législateur n’est rien d’autre qu’un ensemble de forces politiques qui s’affrontent ou s’accordent. Comme Carl Schmitt le soulignait dans Théologie politique, considérer l’État comme un système de normes qui ne servirait qu’à mettre en œuvre le droit du fait du droit lui-même sans s’interroger sur la question de la souveraineté ou de la décision est une impasse conceptuelle.
La démonstration de la nature utopique du Législateur tient justement en ce qu’elle abolit la problématique du prince lié par les lois (princeps legibus alligatus) ou celle se demandant s’il est au-dessus des lois (princeps legibus solutus). Le Législateur fait les lois, il ne leur est pas lié ou délié à proprement parler, parce qu’il partage la même essence qu’elles. Il impose au contraire la loi au souverain, garantissant ainsi l’État de droit, soit la subordination de l’État au droit quand l’État lui-même n’est pas hypostasié. Ce retour à la Lex Digna de Théodose : « adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas » — soit « aussi notre autorité dépend de l’autorité du droit » — est aux antipodes de la fameuse phrase de Louis XV que nous mentionnâmes auparavant : « nous ne tenons notre couronne que de Dieu : le droit de faire des lois… nous appartient à nous seul sans dépendance et sans partage. » Ce n’est pas tant la régression féodale qui est problématique que les conséquences pratiques qu’elle entraîne.La légitimité n’existe pas sans la légalité dans l’État de droit. Mieux même, c’est la légalité qui est la seule source de légitimité, abolissant leur dualisme cher à Carl Schmitt, à son propre regret par ailleurs. Le Législateur lie donc le souverain — peu importe qu’il s’agisse du prince ou de l’État — aux lois et veille à ce qu’il ne puisse s’en délier, ce qui le rattache indiciblement à l’État de droit. La notion de necessitas est en pratique annihilée, et avec elle les recours légaux qui permettent de résoudre les crises, comme la fameuse institution dictatoriale héritée de la République romaine. Machiavel avait notamment compris le problème posé en affirmant qu’à défaut d’un tel recours légalement prévu pour se dégager d’une crise, cela entraînait soit l’instabilité du système, soit l’habitude d’en enfreindre les lois, et même souvent les deux en même temps. En pareille situation, le droit était censé reculer au profit de l’État au nom du salus populi et, in fine, du droit de l’État de se conserver lui-même.
La consécration du Législateur permet finalement d’évacuer la necessitas, dans la mesure où il est l’émanation rationnelle de l’État de droit. Il prévoit évidemment tout ce qu’il y a à prévoir afin que rien ne puisse perturber la situation normale. Les crises ne sauraient être qu’au mieux des épiphénomènes ponctuels qui ne sauraient perturber le bon fonctionnement de l’État de droit, et naturellement la suprématie du droit lui-même. C’est donc un véritable optimum juridique que le Législateur met en œuvre ainsi qu’en veillant à sa bonne exécution.
LE CITOYEN EST MORT
Cette suprématie du droit sur l’ordre institutionnel pris dans son sens le plus large n’est pas sans effet sur le corps social. Dans un système qui se prétend républicain, c’est le citoyen qui demeure justement son institution première. Or, dans un État de droit, seules les choses rationnelles peuvent être appréhendées par le Législateur, puisqu’il ne fait que reconnaître juridiquement des intérêts. Le citoyen, en tant que sujet irrationnel par sa nature même, puisque c’est un homme, est dans la tradition républicaine, le garde-fou à toute dérive du Législateur. C’est le fameux droit à l’insurrection de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 — jamais appliquée —, l’idée de constitution mixte chère à Machiavel, et on pourrait remonter ainsi jusqu’à la sécession de la Plèbe sous la République romaine, sans oublier de titiller la théorie de Polype au sujet du cycle des régimes politiques.
L’Etat de droit tente justement de rationaliser le citoyen, d’en faire un sujet du droit comme un autre. Comme il ne peut appréhender que des logiques froides et que toute entreprise normative sert son renforcement, laisser un facteur imprévisible représente une menace pour lui. L’idée républicaine est ainsi évacuée au profit du droit seul, et le citoyen n’a plus qu’à subir les turpitudes législatrices pour se voir traiter d’agent du chaos s’il venait à les contester.
Plus vraisemblablement, le citoyen dépouillé de sa dimension institutionnelle se voit appréhender par l’Etat de droit en fonction de ses attributs les plus objectifs qui soient. Le cas de l’évolution des libertés fondamentales illustrent à merveille ce glissement vers la consécration de libertés touchant de plus en plus l’intime des individus. De la liberté d’opinion, de réunion et d’association, ont succédé des espèces de libertés nommées dorénavant « individuelles » qui concernent la sexualité ou l’orientation sexuelle, la couleur de peau, parfois même des angoisses existentielles — pas toujours illégitimes — comme celles liées à l’environnement. Le mot liberté n’a plus grand sens, et Michel Villey avait vu juste en affirmant que « la science juridique s’est donné pour tâche de décrire le « law as it is », le droit tel qu’il existe en fait (ce qui d’ailleurs ne signifie rien) ».[2]
En cas de crise sanitaire comme celle provoquée par l’épidémie de Covid-19, la néantisation du citoyen s’est brusquement manifestée à nous. Il n’était plus considéré comme le corollaire d’un individu intellectuellement autonome et encore moins comme un être humain, pas plus qu’il ne subsistait encore dans l’ordre institutionnel. Loin de l’idée républicaine, le citoyen n’était plus la clef de voûte des institutions, mais écrasées par elles. Dans son lent travail de réification, l’État de droit a fini par penser la sauvegarde du citoyen non plus en termes de liberté, mais de contrainte. Le seul moyen rationnel pour lui d’appréhender les conséquences d’une épidémie ne fut pas de trouver des solutions curatives mais d’au contraire exercer un étroit contrôle d’une ampleur inédite sur l’individu. Impossible pour ce dernier de sortir sans justifier de son état de santé pour se rendre dans un lieu accueillant du public, une fois qu’il lui fut possible de sortir de chez lui sans attestation. L’État de droit, incapable de distinguer la vie biologique avec la qualité de vie a évacué cette dernière. De la sorte, il a achevé de paramétrer la biopolitique parmi ses prérogatives de puissance publique. Les mesures de police servies comme autant de fausses garanties de libertés, alors qu’elles sont justement leur exception, ont sacrifié en réalité la liberté sur l’autel du confort. Pour retrouver un semblant de vie, le corps social est ainsi prêt à tous les sacrifices, jusqu’à ce que « vivre libre dans une prison »[3] devienne une servitude volontaire effective.
Cette évolution drastique de notre paradigme de la liberté a cependant eu des effets délétères. Au profit des nouvelles libertés reconnues par l’Etat de droit, ce sont les plus anciennes d’entre elles qui s’effondrent les unes après les autres. Le progrès apportant sans cesse de nouvelles cohortes de besoins à satisfaire, dans la mesure où tout ce qui devient possible finit par devenir nécessaire, l’Etat de droit finit par reconnaître la satisfaction des besoins comme autant d’intérêts légitimes. Quelqu’un comme Portalis serait effaré de constater à quel point les lois positives se sont substituées à la raison naturelle dans les affaires de la vie. Le rejet de la fatalité n’a jamais été aussi fort qu’à l’heure où elle devient de plus en plus marginale. La subordination au désir de tout ce qui nous était impitoyablement imposé par les aléas de la nature ou de l’évolution semble être devenu l’horizon que s’est donné l’humanité. Mieux même, l’État de droit en est venu à assurer la jouissance de tous. Bref, « un État de partis pluralistes ne devient pas « total » par vigueur et par puissance, mais par faiblesse ; il intervient dans tous les domaines de la vie parce qu’il doit satisfaire aux prétentions de tous les intéressés. »[4]
En contrepartie de ces nouvelles avancées, nous abandonnons dans l’indifférence générale les libertés qui nous permettaient d’exercer pleinement notre citoyenneté. Nous ne sommes désormais plus que des individus et dans le marasme d’une égalité confondue avec la standardisation des êtres, nous ne nous rendons pas compte que « rendre les femmes juridiquement identiques aux hommes, les bébés aux personnes âgées, et les pauvres aux riches serait détruire la richesse du monde et sa variété ; un triomphe de l’entropie. »[5]
Pourtant, l’Etat de droit pourrait être considéré comme le « plus froid des monstres froids » selon la formule consacrée par ce bon Friedrich Nietzsche. Le droit, en tant que phénomène objectif pur, ne semble pas à première vue susceptible de dérive, ni même de dégénérescence, comme l’imagine notamment la pensée libérale. Le positivisme comme réalité juridique s’est détaché cependant de l’idée de justice. En procédant de l’État jusqu’à le dominer complètement, il s’est doté d’une parure pseudo-scientifique faisant oublier sa nature pourtant fictionnelle. Il serait le jeu d’un mouvement spontané des institutions et de l’administration et non plus de règles politiques, qu’elles soient démocratiques ou tyranniques d’ailleurs. « Désormais tout l’ordre juridique procède de l’Etat et se trouve enfermé dans ses lois. C’est le positivisme juridique, philosophie des sources du droit qu’acceptent la plupart des juristes et qui les dispense, en les soumettant à la volonté arbitraire des pouvoirs publics, de la recherche de la justice. »[6]
Notes :
[1] Boris Mirkine-Guetzévitch, in « La démocratie de l’Europe nouvelle », p. 11, éd. Delagrave (Paris, 1928)
[2] Michel Villey, in « Le droit et les droits de l’homme », éd. PUF
[3] Curzio Malaparte, in « La Technique du coup d’État », préface
[4] Carl Schmitt, in « Légalité et légitimité », Conclusion, p.133-134, éd. Les presses de l’Université de Montréal, trad. de Christian Roy et Augustin Simard
[5] Michel Villey, in “Le droit et les droits de l’homme”, I- La question de droits de l’homme, p.12
[6] Michel Villey, in “Le droit et les droits de l’homme”, I- La question de droits de l’homme, p.8 éd. PUF